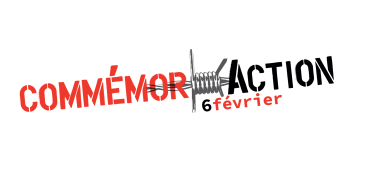Les migrations environnementales, quèsaco ?
Extrait de la brochure de la FASTI sur les migrations environnementales
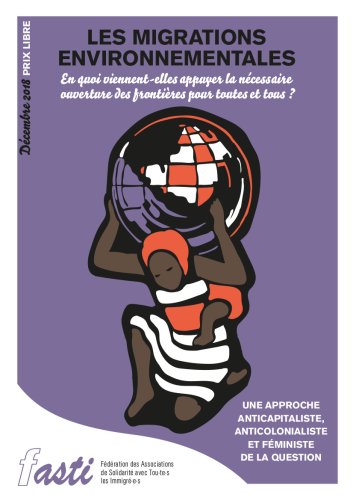
Éléments de définition :
La sémantique pour nommer les déplacements de population en raison d’une dégradation de l’environnement est plurielle.
Les migrations climatiques se rapportent à des changements progressifs (sécheresse chronique, montée du niveau de la mer, etc.) liés à la montée de la température moyenne. Elles ne sont pas récentes mais prennent une place grandissante du fait de l’accélération des phénomènes qui les provoquent.
Les migrations écologiques se rattachent à des catastrophes soudaines d’origine naturelle ou industrielle (pollutions chimiques ou radioactives, glissement de terrains suite à la déforestation, etc.). Elles résultent d’une obligation précipitée de fuir son habitat et son environnement local.
Les migrations environnementales englobent les migrations climatiques et écologiques. Elles sont donc liées à un changement environnemental soudain ou progressif, impactant les conditions de vies des personnes et les contraignant à trouver refuge soit dans une région proche soit dans une région beaucoup plus lointaine.
Les migrations environnementales sont très anciennes. Depuis l’origine de l’humanité, l’environnement est un facteur de mobilité et un déterminant de la répartition de la planète à l’échelle mondiale. Plus globalement, les migrations sont inscrites dans notre histoire commune et sont inhérentes à l’humanité.
Quelques caractéristiques, quelques chiffres :
Les migrations environnementales sont très difficiles à quantifier en raison de leur diversité. Certaines migrations sont temporaires, d’autres permanentes. Certaines sont internes à un même pays, d’autres sont internationales.
Les plus quantifiées sont celles qui résultent de catastrophes naturelles et qui trouvent un écho solidaire et médiatique (et donc un intérêt comptable) particulièrement important. Ainsi, on estime que chaque année, 27,5 millions de personnes se déplacent en moyenne suite à une catastrophe naturelle1. Il faudrait ajouter à ce chiffre toutes les personnes qui migrent en raison des bouleversements plus lents de leur environnement.
Plusieurs rapports et études analysent les migrations environnementales comme étant essentiellement des migrations internes (à hauteur de 95% environ). Cette donnée permet de nuancer les estimations alarmistes sur l’ampleur de ces migrations et contrer leur instrumentalisation qui alimente la peur de l’ « invasion ».
Les migrations internationales, quant à elles, se font majoritairement d’un pays du Sud vers un autre pays du Sud. Tel est également le cas des migrations liées au climat qui touchent particulièrement l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Afrique de l’Ouest et l’Asie du Sud-est.
Seule une très petite minorité, dotée de moyens financiers suffisants et en capacité de se déraciner, émigre de son continent en acceptant de fait l’exil lointain. La plupart des autres quittent un lieu vulnérable pour un autre lieu vulnérable. En effet, rares sont les autorités locales en capacité de réinstaller les personnes contraintes de fuir leur région dévastées. Les solutions ultra-précaires de campements ou d’abris se multiplient autour des zones sinistrées ou aux portes d’autres régions plus lointaines censées être plus hospitalières.
La crise environnementale frappe les personnes qui restent sur place et celles qui ont pu fuir. Elle provoque des déplacements forcés qui se prolongent par une crise de l’accueil.
Un statut protecteur pour les migrant-e-s environnementales/aux : que reste-t-il des « bonnes intentions » ?
Les migrations environnementales, qui se caractérisent par l’obligation pour les personnes de fuir un danger et de chercher refuge ailleurs, conduisent certain-e-s à retenir le terme de réfugié-e.
Plusieurs tentatives de définitions et légalisations dans ce sens ont été émises. Le concept de réfugié-e-s environnementales/aux est apparu officiellement en 1985 dans un rapport pour le Programme des Nations unies pour l’environnement, le PNUE. L’auteur, Essam El-Hinnawi, définissait les réfugié-e-s environnementales/aux comme « ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie ».
Dans un communiqué du 11 octobre 2005, Janos Bogardi, directeur de l’Institut universitaire des Nations unies pour l’Environnement et la Sécurité Humaine (UNU- EHS) estimait qu’il était « nécessaire que cette nouvelle catégorie de réfugiés environnementaux puissent trouver une place dans le cadre d’accords internationaux existants ».
Par ailleurs, la Suisse et les Norvège ont lancé l’initiative Nansen en 2015 en dehors des circuits onusiens. Cette initiative intergouvernementale regroupant 110 pays a permis de définir un « agenda de protection » ayant pour objectif de créer un cadre légal international pour les migrant-e-s environnementaux.
Sans surprise ces annonces institutionnelles n’ont eu aucun effet et rien n’a concrètement évolué pour les droits des migrant-e-s environnementales/aux. Aucune possibilité ne s’offre aujourd’hui à elles/eux pour prétendre à une protection au titre des bouleversements environnementaux de leurs lieux de vie. Les persécutions vécues ne donnent lieu à aucune reconnaissance institutionnelle.
La première tentative pour tenter de faire reconnaître une protection juridique à un réfugié climatique a concerné un habitant de l’archipel des Kiribati. Il s’est vu refusé par la Nouvelle-Zélande sa demande de statut de "réfugié climatique" en octobre 2013. Son avocat avait expliqué qu’il était persécuté, de manière passive, par les circonstances dans lesquelles se trouve son pays natal, et que le gouvernement des Kiribati ne pouvait en aucun cas améliorer sa situation. Un autre cas s’est manifesté en Australie par la demande en vain d’un citoyen des îles Fidji. Ces premières jurisprudences sont symptomatiques du vide juridique pour les personnes forcées de quitter leur lieu de vie pour des raisons environnementales.
Appréhender les migrations de façon globale et égalitaire
Il est difficile d’isoler la question environnementale de l’ordre économique qui le produit et qui influe sur un contexte général marqué par des crises économiques, sociales, climatiques et politiques. Aussi, il est arbitraire de catégoriser les personnes migrantes, tour à tour cataloguées de « migrant-e-s économiques », de « migrant-e-s ou réfugié-e-s climatiques » ou de « réfugié-e-s politiques ».
En parallèle de la question purement éthique, cette catégorisation ne repose sur aucun bien fondé scientifique car les facteurs à l’origine des migrations sont multiples et toujours interdépendants les uns des autres. Elle sert seulement les intérêts des Etats du Nord qui peuvent ainsi « hiérarchiser », « trier » les personnes migrantes et choisir celles qu’ils vont « accueillir » sur leur territoire. Ce tri entre « bons » et « mauvais » migrant-e-s est notamment fondé par une logique utilitariste au gré de la demande conjoncturelle de main d’œuvre immigrée. Ses conséquences sont dramatiques puisqu’elle alimente les amalgames xénophobes et les réflexes nationalistes et populistes qui prennent racines dans les sociétés occidentales depuis des dizaines d’années.
Dans la volonté de trier les personnes migrantes, apparaît également la notion de « migrations forcées » et « migrations volontaires ». La « migration forcée » est définie à partir d’un événement le plus souvent soudain : une persécution, une catastrophe naturelle ou environnementale. Elle a introduit le statut de réfugié-e pour les personnes exposées à des persécutions (à l’exception notamment des persécutions environnementales) et rien pour les autres. La « migration volontaire » serait exclusivement économique ou familiale.
Tant pour des raisons politiques, familiales, économiques, environnementales et culturelles, le déplacement des personnes sur notre globe restera intrinsèque à l’humanité. L’enjeu est donc celui de l’appréhension globale des migrations et de l’abandon de cette posture coloniale permettant de juger de la légitimé ou non de migrer.
Bon nombre des migrations sont dues à la montée des inégalités avec leurs conséquences sociales, l’accaparement des richesses et le carcan des politiques libérales imposées dans les quatre coins du monde. La lutte pour la liberté de circulation et d’installation des personnes ne peut donc faire l’impasse de l’ordre économique qui produit une multitude de murs visibles ou non entre les personnes : l’ordre néolibéral.
Qu’en est-il de la Convention de Genève ?
Le statut de réfugié est juridiquement défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (Convention internationale sur l’asile) : le/la réfugié-e est la personne qui « craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Cette définition ne prévoit pas les situations de personnes contraintes de se déplacer en raison de la montée des eaux, de la destruction des ressources nutritives ou de la contamination durable des sols et de l’air.
Plusieurs objections à s’appuyer ou à amender la Convention de Genève dans l’objectif d’encadrer le statut des migrant-e-s environnementales/aux sont régulièrement avancées. L’une d’entre elles porte sur la notion de « persécution » qui ne serait pas caractérisée par les événements climatiques et environnementaux. L’asile est par ailleurs octroyé en raison du caractère individuel de la persécution, il n’est donc pas reconnu à un ensemble de personnes partageant la même oppression.
D’autres réticences tiennent à une vision critique de cette Convention, de plus en plus contestée en raison de l’application qui en est faite par les pays qui l’ont ratifié, y compris par les pays occidentaux qui en ont été à l’origine.